Patriotisme, souverainisme et modernité - Interview de Jacques SAPIR par PATRIOTES DISPARUS - 25/05/2019

Économiste connu et reconnu pour ses positions eurocritiques et pour la démondialisation, directeur à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), directeur du CEMI et membre de l’Académie des Sciences de Russie, Jacques Sapir développe notamment ses analyses politiques, économiques et sociales ou encore sur la crise de l’État sur son influent blog Russeurope et désormais « Russeurope en exil » sur le site Les Crises. Auteur de La Démondialisation (Le Seuil, 2011) et dernièrement de Souveraineté, Démocratie, Laïcité (Michalon, 2016).
CERCLE DES PATRIOTES DISPARUS : L’articulation entre le patriotisme ou souverainisme et la modernité semble être peu abordée. Leur confrontation semble pourtant toujours apparaître à travers celle entre souveraineté et mondialisation, la première étant critiquée comme une notion obsolète et l’autre prétendant s’inscrire dans la marche à sens unique d’un progrès idéologisé. Pourrait-on la qualifier de nouvelle querelle entre les Anciens et le Modernes selon vous ?
JACQUES SAPIR : Parler, à cet égard, de « querelle des Anciens et des Modernes » me semble réducteur. Les notions de « patriotisme » et de souveraineté ne se laissent pas enfermer dans ce genre de cases. Nous sommes plus ici dans une opposition fondamentale qui traverse l’histoire. D’ailleurs, ne pourrait-on voir dans cette volonté (actuelle) d’effacer les nations en fait une volonté de revenir aux temps féodaux (grand thème par ailleurs de la Science-Fiction) ? Donc, qui sont les anciens et qui sont les modernes en cette querelle ?
La notion de Nation (au sens d’une communauté politique organisée par des institutions spécifiques et territorialisée) est ancienne. Elle trouve une première expression, incomplète, dans la « Cité » antique, mais où la notion de « frontière » est moins importante car l’espace de l’époque est peu peuplé (entre 4 et 8 millions d’habitants pour la Gaulle). Elle renait en France, au Moyen-âge, de Bouvines[1] (1214) à Jeanne d’Arc (1412-1431), ce que constate très paradoxalement, mais aussi très logiquement un internationaliste comme Daniel Bensaïd[2]. Cette dernière, au-delà du mythe et de la légende dorée qui l’entourent, représente et témoigne de l’existence d’un « sentiment national », autrement dit une forme de patriotisme, dans la France de l’époque. Les deux siècles qui séparent la bataille de Bouvines de la naissance de Jeanne d’Arc sont le creuset tout à la fois de la naissance de la nation et du sentiment national, et de la naissance de l’État.
Car, l’État a bel et bien existé bien avant l’évolution qui a conduit à l’État moderne qui n’est qu’un sous-ensemble dans la catégorie « État ». L’émergence de ce dernier, la distinction entre la principauté comme principe et la principauté comme propriété du Prince, se déroule dans le Moyen Age. En France, c’est avec le règne de Philippe le Bel (1285-1314) que l’on commence à voir s’autonomiser un appareil d’État, avec la montée en puissance des « légistes royaux »[3] dont le champ des attributions dépasse largement celui de la propriété royale. C’est sous son règne que le double mouvement de lutte contre les seigneuries locales et contre un pouvoir à vocation internationale (celui du pape) a pris toute son ampleur[4]. La dissociation entre la « propriété du Prince » et l’État où le Prince est souverain s’affirme par étape. Commencée avec Philippe-Auguste[5], magnifiée par les conquêtes militaires du roi[6], consolidée par la naissance d’une « idéologie royale », elle est à peu de choses complètes sous Philippe le Bel. Cette dissociation entre la propriété privée du Prince et son pouvoir public sort renforcée de l’épreuve de la guerre de 100 ans, où commence à s’affirmer un patriotisme français.
L’histoire de la constitution d’une « nation » et du « sentiment national » qui va avec n’est pourtant par un long fleuve tranquille. Elle se heurtera au début du XVIème siècle à l’expression d’identités religieuses exacerbées quand la Renaissance donnera vie à la Réforme. Les Guerres de Religions auraient très bien pu signifier la dissolution de ce sentiment national en voie de constitution, et avec lui la dissolution de la nation. De toutes les guerres civiles, le conflit inter-religieux est le plus inexpiable car il met en jeu des fins qui dépassent l’échelle humaine. Quand ce qui est en cause est la vie éternelle – pour qui y croit – alors tout devient possible et justifié dans ce que l’on considère alors comme la « vie terrestre » pour atteindre cette « vie éternelle ». Une finalité extrême peut engendrer une barbarie extrême. La guerre de religions est aussi le conflit qui déstructure le plus en profondeur une société, qui dresse les enfants contre les parents, les frères contre les frères. A travers l’épisode de la « Sainte Ligue », le drame de la Saint-Barthélemy en 1572[7] (et dans une bien moindre mesure celui de la Michelade de Nîmes), se pose ouvertement la question : appartient-on à une communauté politique ou à une communauté religieuse ? Ainsi, le Duc de Guise se met secrètement au service du Roi d’Espagne, vu comme protecteur des catholiques, à qui il quémande argent et troupes. Certains dignitaires protestants en feront autant avec la couronne d’Angleterre. La crise de la Nation est alors aussi une crise de l’État ; « Il n’y a d’irrémédiable que la perte de l’État » a dit un roi de France[8] en des temps anciens, mais qui semblent aujourd’hui étrangement, et tragiquement, proches. Quand Henri IV fit cette déclaration devant les juges de Rouen, un Parlement à l’époque était une assemblée de juges, il voulait faire comprendre qu’un intérêt supérieur s’imposait aux intérêts particuliers et que la poursuite par les individus de leurs buts légitimes ne devait pas se faire au détriment du but commun de la vie en société. En redonnant le sens de la Nation, il mit fin à la guerre civile. Mais un seul homme ne peut tout. La démarche d’Henri IV s’inscrit dans le travail tant politique qu’idéologique réalisé par ceux que l’on nommait les « Politiques »[9], catholiques et protestants persuadés dès avant le massacre de la Saint-Barthélemy que l’unité de la nation, que le maintien d’un espace politique commun au-delà des divergences religieuses était ce que l’on appellerait aujourd’hui un « bien public », et que ce bien méritait que l’on mette une sourdine à ses propres croyances.
En déclarant ouvertement la guerre au Roi d’Espagne, Henri IV dévoile les intentions hégémoniques qui se cachent sous le manteau de la religion. Et, cela va réveiller le sentiment national qu’avait pu endormir la fureur sectaire. Ce patriotisme va révéler toute sa force au XVIème siècle sous Henri IV. La bataille, on aurait envie de dire « l’escarmouche »[10], de Fontaine-Française symbolisant l’union des Catholiques et des Huguenots Français contre le roi d’Espagne[11]. Désormais, la Nation se substitue au lien religieux comme lien principal. La majorité des contemporains se définissent dès lors comme « Français » et non plus à travers leur allégeance religieuse. Quels que puissent être les soubresauts de l’histoire, et les tentatives pour revenir en arrière, il y a là un acquis fondamental.
Le sentiment national, le patriotisme, devient dès lors ce qui fait ciment dans la communauté politique. Et, quand s’éveillent les aspirations à la démocratie en 1789, la frontière irrémédiable sera bien celle qui opposera ce sentiment national au sentiment de caste.
On le sait, la « mondialisation » n’est pas une nouveauté. Elle n’est pas « moderne » et peut même recouvrir des régressions très archaïques. Elle a pu se parer des atours de la religion comme elle se pare aujourd’hui de ceux de la marchandise et de l’argent. Face au risque permanent de dissolution de la communauté politique territorialisée, de la nation, dans le cadre de ces différentes mondialisations, le sentiment national, l’idée qu’au-delà de nos légitimes divergences la défense de notre identité politique et de nos institutions nous rassemble, reste fondamentale.
Les porteurs du projet de la mondialisation comme de la construction européenne – et plus avant de tout ce qui compose le « monde moderne » que nous connaissons – usent d’un vocabulaire résolument positif et progressiste. Serge Latouche dit par exemple de la mondialisation que « Le vocable est loin d’être innocent, il laisse entendre qu’on serait en face d’un processus anonyme et universel bénéfique pour l’humanité. » La plus grande difficulté des souverainistes et autres patriotes ne résiderait-elle pas finalement dans le langage ?
Chacun peut jouer avec les mots, leur faire dire d’autres choses, voire le contraire de ce qu’ils signifient dans la tradition du langage. Il en est ainsi du « fascisme » utilisé pour désigner simplement ce que l’on n’aime pas, et qui devrait en réalité être réservé à un usage bien plus précis et contextualisé. C’est un processus décrit dans 1984 de G. Orwell (« La paix, c’est la guerre », etc.). D’une manière générale, la vie politique est remplie de manipulations de termes, de manipulation de l’histoire, de manipulations de mémoires. C’est aujourd’hui un phénomène général, qui dit beaucoup de choses sur les temps que nous vivons où celui qui crie le plus fort s’imagine qu’il a raison.
Mais, les difficultés que rencontrent les souverainistes ne viennent pas du langage ou, plus précisément, ne viennent pas principalement du langage. Elles viennent de ce qu’ils affrontent des intérêts puissants, organisés, prêts justement à toutes les manipulations et les falsifications, pour imposer leurs vues. Il en est ainsi de l’argument « l’Europe, c’est la paix », qui est à la fois faux, nous savons que la paix en Europe provient d’un contexte politique, la « Guerre Froide », et de l’acquisition par la France de l’arme nucléaire, mais qui pourrait être aussi taxé d’être un but d’immoral. Prétendre que la « paix » est le but suprême revient à légitimer les oppressions les plus affreuses, les tyrannies les plus terribles. La paix dans l’esclavage n’est pas la paix. Il ne peut y avoir de paix qu’entre des femmes et des hommes libres. Les hommes libres doivent être prêts à prendre les armes pour défendre les libertés (et non « la » liberté). Ainsi, la paix ne saurait être instituée en but suprême. Le pacifisme « ultra », né devant l’horreur de la Première Guerre Mondiale a conduit à des choses toutes aussi horribles lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le reconnaître ne revient pas à « souhaiter » la guerre, ce que nul de sensé ne peut faire, mais à reconnaître que la violence, et même la guerre, peuvent être dans certaines situations des issues nécessaires. Car, bien souvent, la décision de passer de la paix à la guerre est imposée…
Ces difficultés que rencontrent les souverainistes viennent aussi de ce qu’ils sont souvent inutilement divisés, même si les usages de la souveraineté sont naturellement divers. S’il est naturel et légitime que les souverainistes défendent des idées opposées quant à l’organisation de la « Cité », ils devraient comprendre qu’ils doivent faire cause commune pour la défense de la liberté de la « Cité », c’est-à-dire de la liberté du peuple, à prendre des décisions. Cette conscience est en train d’émerger en Italie, où l’on voit des forces politiques issues de la gauche traditionnelle soutenir l’action du gouvernement de coalition Lega–M5S quand la question de la souveraineté nationale est en jeu. Ces forces, dans le même temps, ne ménagent pas leurs critiques à ce même gouvernement sur d’autres points. Même la France Insoumise a pris position pour défendre le droit du gouvernement italien d’appliquer le budget voté par le Parlement et le Sénat[12]. Sur ce point, les choses progressent, certes lentement, mais elles progressent.
Ces difficultés viennent enfin de ce que les souverainistes peinent à trouver l’articulation entre la souveraineté et les conditions immédiates d’existence des citoyens. Cette articulation est pourtant évidente, mais elle est aussi cachée par le mouvement immédiat des choses qui focalise l’attention des citoyens sur des problèmes qui, en apparence, n’ont pas de rapport avec la souveraineté alors qu’en réalité cette même souveraineté est indispensable à l’émergence de solutions concrètes à ces problèmes.
Alors, que les partisans de la « mondialisation » cherchent à la présenter comme un phénomène « naturel », participant en cela de cette naturalisation de la politique qui en est sa négation, est évident. Mais, ce genre de présentation ne date pas du débat entre souverainistes et « mondialistes » ; elle est en réalité très ancienne dans le combat politique. Les souverainistes doivent ici prendre la position des sciences sociales pour démonter ce type d’argument, pour argumenter qui rien, en politique cela s’entend, n’est jamais « naturel », et que le discours de naturalisation cache toujours des intérêts et des forces politiques qui savent qu’elles ne peuvent se risquer de se présenter à nu au peuple. Mais, faire ce nécessaire travail n’exonère nullement de faire aussi, et peut être surtout, celui qui consiste à montrer l’importance quotidienne de la souveraineté, la centralité de l’enjeu, et en quoi tout le monde est bien concerné par le combat pour la souveraineté.
Dans son discours polémique « Race et Culture », Claude Levi-Strauss comparait les barrières culturelles aux barrières biologiques, affirmant que « pleinement réussie, la communication intégrale avec l’autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l’originalité de sa et de ma création.» N’est-ce pas là la contradiction suprême d’une modernité qui, au nom du progressisme qu’elle applique à coup de traités de libre-échange et autres mesures économiques, finit par se révéler destructrice de toute forme d’altérité ?
La citation que vous faites de Claude Levi-Strauss est curieuse. On peut penser, à la lire, qu’il n’a pas une conception vraiment claire de la dialectique, et qu’il a une vision pour le moins simpliste des problèmes de communication, ce qui serait pour le moins surprenant pour cet auteur. Il convient en effet de savoir, d’une part, qu’il ne peut y avoir de communication intégrale avec l’autre. Une communication intégrale impliquerait que je pense exactement (et au même moment) ce que pense l’autre. Ceci est donc rigoureusement impossible. D’autre part, et c’est là où la dialectique entre en jeu, une « bonne » compréhension de ce que fait l’autre ne condamne nullement ce que je fais moi-même (et réciproquement) car même dans la reproduction d’une création il y a de fait une autre création originale (ne serait-ce que dans l’intention). Donc, une « bonne » communication peut conduire à des fécondations réciproques, mais nullement à une identité de création, car même dans mon désir (s’il existe) d’imiter, je ne puis répliquer l’objectif du premier concepteur. Il faut donc considérer qu’une « bonne communication », qui elle est du domaine du possible et doit être visée, permet en réalité de dynamiser les créations réciproques. Ce que Levi-Strauss décrit ici en réalité, ce n’est pas le phénomène de « communication » mais bien celui d’acculturation, une acculturation qui signifie non que deux cultures communiquent, mais que l’une désintègre l’autre, voire que les deux se désintègrent symétriquement.
La mondialisation a effectivement permis à des cultures dominantes, et ces cultures sont dominantes non pas pour des raisons morales mais parce qu’elles s’appuient sur des artefacts qui impliquent une supériorité technique, industrielle, militaire, de dominer les autres et de les acculturer. Une grande partie des drames que nous vivons, du fanatisme religieux qui a saisi une partie du monde musulman par exemple, jusqu’aux phénomènes migratoires que nous voyons se déployer, trouve là sa cause. Mais, cela implique-t-il que nous devions aller dans un relativisme absolu entre les cultures ? N’existe-t-il pas un noyau de principes universels, comme la distinction entre la sphère privé et la sphère publique, la condamnation de mutilations imposées, celle de l’esclavage, qui devrait s’imposer aux diverses cultures ? Dit en d’autres termes, une pratique comme l’excision doit-elle être tolérée au motif qu’elle est pratiquée dans un autre cadre culturel ? La question de la relation entre l’autonomie de chaque culture et les principes universels ne se laisse pas aborder à partir de raccourcis et de simplifications.
Il faut donc reprendre l’interrogation que vous posiez sous d’autres termes. Levi-Strauss a repris la définition de la culture d’Edward Taylor : « « ce tout complexe qui comprend les savoirs, les croyances, l’art, la morale, la coutume et toute capacité ou habitude acquise par l’homme en tant que membre de la société »[13]. Il y ajoute que les éléments constitutifs d’une culture ne sont pas un agrégat sans cohésion de ces diverses dimensions citées, agrégat résultant du jeu des circonstances. Les agrégats qui constituent des cultures forment système et leur association bénéficie d’une relative stabilité dans le temps[14]. Le système dont il est question peut définir une société. Levi-Strauss, à la suite des premiers géographes et ethnologues, reconnaît la diversité des cultures. Il la tient même comme nécessaire à l’espèce humaine. Mais, comment alors penser à la fois l’unité du genre humain et la diversité nécessaires des cultures ? Même si elle a été contestée par des extrémistes, la thèse de l’unité du genre humain, confirmée par la science et les travaux sur l’ADN, s’est s’imposée à la conscience collective. Et, si l’homme est un, alors la question des principes universels ne peut être écartée d’un revers de main, quand bien même l’expression de ces principes auraient été défigurée (et elle l’a été à l’évidence) par des instrumentalisations dans le cadre justement de processus d’acculturation. Alors, il faut passer du concept de culture à celui de société.
Claude Levi-Strauss a eu raison dans son œuvre de distinguer les sociétés froides des sociétés chaudes. On sait qu’il définit les premières comme des sociétés qui, après avoir évolué, résistent à tout changement et cherchent à s’isoler de l’histoire, et les sociétés chaudes comme celles qui sont capables en permanence de changements mais il indique aussi, dans un texte tardif, que des sociétés froides peuvent se « réchauffer » au contact d’autres sociétés et d’autres cultures[15]. C’est pourquoi, d’ailleurs, il associe le progrès au contact. Il conclut d’ailleurs, dans le livre Races et Histoire en disant ceci : « L’exclusive fatalité, l’unique tare qui puissent affliger un groupe humain et l’empêcher de réaliser pleinement sa nature, c’est d’être seul »[16]. Il nous faut donc distinguer précisément ce qu’est le contact, qui est dans la nature des choses et qui est très ancien, de la « mondialisation » ou bien, car le mot est souvent utilisé comme un synonyme, de la « globalisation ».
La « mondialisation » est un projet politique, porté par certaines entreprises, par les banques, par les gouvernements de certains pays[17]. La « mondialisation » combine un libre-échange généralisé avec une circulation des capitaux sans entraves. D’un point de vue purement économique, cela implique la mise en connexion des différents systèmes économiques nationaux, avec toutes les perturbations que cela entraîne. A ces phénomènes purement économiques viennent s’ajouter ce que l’on peut appeler la manufacture du « village global », une expression qui est fausse en cela que ce village n’est pas réellement global, une grande partie de la population reste à la périphérie, et l’émission des flux d’informations (et de représentations culturelles) n’est-elle même pas globale, mais largement déterminée par certaines sociétés. C’est à ce niveau que s’exprime à la fois l’effet de « cultures (s) » dominantes, mais aussi les effets d’acculturation.
Il faut donc reprendre et lire jusqu’au bout la citation que vous avez mise dans votre questions : «Toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs, pouvant aller jusqu’à leur refus, sinon même à leur négation. Car on ne peut à la fois se fondre dans la jouissance de l’autre, s’identifier à lui et se maintenir différent.
Pleinement réussie la communication intégrale avec l’autre condamne, à plus ou moins brève échéance, l’originalité de sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquente et rapide pour que les obstacles, indispensables entre les individus comme entre les groupes, s’amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confondent la diversité »[18]. Ce dont il est question dans cette citation, c’est de la « bonne distance » entre soi-même et autrui, une notion qui me semble ici directement empruntée, et avec de bonnes raisons, de la psychanalyse[19]. Ce que dit Levi-Strauss n’est donc pas qu’il ne faille pas communiquer, mais qu’il faut dans cette communication, et dans le contact entre deux cultures, chercher ce juste milieu qui permet donc le contact mais qui empêche la confusion. Appliquée dans la sphère économique, cela pourrait être une justification du protectionnisme comme juste milieu entre l’autarcie (car la communication doit exister et être « suffisante ») et le libre-échange (condamné avec la notion des « échanges trop faciles »).
Les effets de la « mondialisation » économique peuvent se cumuler ou s’opposer avec les effets de globalisation des représentations culturelles et des informations. Mais, tous ces effets, loin d’effacer les différences, les reproduisent en permanence. La globalisation ne conduit nullement à une convergence globale, contrairement à ce que certains prétendent. Mais, et c’est sans doute le point fondamental, la mondialisation perçue comme un phénomène global (et pas seulement économique et financier), implique que cette différenciation (ou plus précisément cette redistribution de la différenciation des sociétés) ne puissent plus être maîtrisée ou simplement pensée par les sociétés et pas les individus organisés en communautés politiques, autrement dit les peuples. Le problème donc n’est pas l’opposition entre mondialisation et diversité mais bien plus est-ce que la mondialisation ne rend pas non-maîtrisable politiquement les changements de cette diversité. Autrement dit, est-ce que la mondialisation n’est pas contradictoire avec la politique ? Et, la politique, en tant qu’art de gérer des intérêts divergents provenant de l’irréductible diversité des groupes d’individus, n’est-elle pas la condition pour que des groupes soient en contact sans chercher à se détruire ?
En matière de souveraineté, c’est souvent la question économique – et de la nationalité économique – qui se révèle la plus problématique, car la plus changeante au fil des époques et des échanges, sans compter la question de l’autonomie du capital et du marché qui ne coïncident plus avec les logiques de l’État. Au final, existe-il ou pourrait-il exister une véritable summa potestas économique ?
Effectivement, la question de la souveraineté en matière économique est cruciale. Mais cette question n’est pas une question économique mais en réalité politique. Il faut en être conscient même si, dans le combat mené pour rétablir une souveraineté dans le domaine économique, il convient de se plier aux méthodes de l’économie. J’ai ainsi toujours eu conscience, quand je m’exprimais pour des formes de protectionnisme ou pour une sortie de l’Euro, que j’étais en terrain politique, même si une partie de mes arguments, et l’analyse que je pouvais faire des situations créées par le Libre-Echange et par l’Euro, s’enracinaient dans une compréhension économique de ces phénomènes.
De fait, les termes du débat ont été parfaitement posés par Keynes dans un texte qui fut publié en juin 1933[20]. Dans ce texte Keynes ne remet pas directement en cause la « vertu » économique théorique du Libre-Échange, même s’il considère qu’elle s’épuise rapidement. Il considère cependant que ses effets sociaux mais aussi politiques en sont désormais insupportables. Le cœur de son argumentation est d’ailleurs très proche des thèses de Veblen quant aux effets sociaux et politiques de l’émergence d’une classe de capitalistes passifs[21]. On avait déjà connu, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, un processus d’accumulation extrême de la richesse, une situation vers laquelle nous tendons à nouveau aujourd’hui.
C’est dans l’opposition entre la réalité sociale des producteurs, insérés dans un contexte national bien spécifié, et la dimension apatride des capitalistes, qu’il identifie la contradiction principale. Il serait aujourd’hui possible de reformuler sa position à la fois dans le vocabulaire marxiste et dans celui d’un institutionnalisme qui serait fondé sur les avancées récentes de la psychologie expérimentale[22]. Dans le premier, nous dirions que l’aliénation propre au salariat devient particulièrement insupportable quand salariés et capitalistes se meuvent dans des espaces politiques, mais aussi souvent géographiques (et l’on pense aux travaux de Christophe Guilluy[23]), différents. Dans le second, nous analyserions la séparation entre le contexte des producteurs (contexte déterminé par ce qu’ils vivent et ressentent mais aussi par l’asymétrie de dotation en moyens matériels, culturels et politiques) et celui des propriétaires comme susceptible d’engendrer un conflit insoluble des préférences, car ces dernières sont construites justement par les contextes[24].
Keynes voyait d’ailleurs dans cette opposition un risque de guerre. Pour lui, ce que nous appellerions aujourd’hui la mondialisation n’est pas et ne peut être (ce point est important) un vecteur de paix. Celle-ci ne peut être garantie que par un retour sur les cadres nationaux, c’est-à-dire à la souveraineté populaire seule capable de donner une légitimité aux décisions prises. La multiplication des conflits militaires et interventions armées que nous avons connues depuis la fin de la « Guerre Froide », ou la montée des tensions de plus en plus violents au sein de l’Union européenne, que ce soit dans l’affrontement entre la Grèce et l’UE, celui aujourd’hui entre l’Italie et l’UE, mais aussi les conflits évidents qui opposent la Hongrie, la Pologne, voire l’Autriche à Bruxelles, semble lui donner tragiquement raison. Mais, la défense par Keynes de l’autosuffisance, terme qu’il ne faut pas confondre avec l’autarcie, ne se justifie pas seulement au nom de la paix. Le Libre-Échange, et en particulier la circulation libéralisée des capitaux[25], prive les nations de la liberté de leurs choix sociaux. Pour Keynes, il est intéressant de constater qu’il considère que le Libre-Echange condamne à terme l’existence de la propriété privée et empêche le fonctionnement des institutions démocratiques. C’est un point que l’on peut, aujourd’hui, entièrement partager[26]. Keynes voit aussi dans cette généralisation du Libre-Echange un obstacle à l’émergence de cette nécessaire diversification des trajectoires au sein du capitalisme qu’il appelle de ses vœux. Nous sommes ici fort proches du raisonnement tenu par Levi-Strauss et que l’on a évoqué plus haut. Il faut ici savoir que Keynes ne parle pas au nom d’une « Révolution anticapitaliste ». Il se veut au contraire le défenseur des valeurs d’une société ouverte et pluraliste. Robert Skidelsky le considérait d’ailleurs comme le « dernier des grands libéraux anglais »[27]. Mais, il est clair que Keynes ne voit pas d’autre avenir que le chaos, la dictature et la guerre si l’on s’inscrit dans la poursuite du Libre-Échange. Celui-ci conduit à n’accepter comme valeur que celles de la finance. Son refus du Libre-Échange est aussi le refus d’une tendance visant à tout réduire au statut de marchandise, processus dans lequel il voit la destruction finale de la culture humaniste occidentale.
Alors, il est aujourd’hui clair que même si les chaînes de valeur se sont énormément complexifiées et même s’il n’est nullement souhaitable ni même possible de revenir à une situation d’autarcie (qui hors de l’état de guerre n’a pratiquement jamais existée), la question de la souveraineté économique est une dimension nécessaire de la souveraineté. Cette souveraineté économique, qui se décline en souveraineté monétaire, en maîtrise des échanges et des flux, n’est pas une simple question économique (même si elle fait appel à une expertise économique) mais elle constitue un objet politique fondamental. Il nous faut donc, pour reprendre une ancienne formule, remettre la politique au poste de commande.
[1] Baldwin J.W. et W. Simons, « The Consequences of Bouvines », French Historical Studies, vol. 37, no 2, printemps 2014. Voir aussi le magnifique Duby G., Le dimanche de Bouvines – 27 juillet 1214, Paris, Gallimard, 1973.
[2] Bensaïd D., Jeanne de guerre lasse, Paris, Gallimard, « Au vif du sujet », 1991.
[3] Favier J., Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », in Journal des savants, no 2, 1969, p. 92-108. Idem, Un Conseiller de Philippe le Bel : Enguerran de Marigny, Paris, Presses universitaires de France, (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes), 1963.
[4] Voir Carré de Malberg R., Contribution à la Théorie Générale de l’État, Éditions du CNRS, Paris, 1962 (première édition, Paris, 1920-1922), 2 volumes. T. 1, pp. 75-76.
[5] Flori J., Philippe Auguste – La naissance de l’État monarchique, éditions Taillandier, Paris, 2002 ; Baldwin J.W., (trad. Béatrice Bonne, préf. Jacques Le Goff), Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge, Paris, Fayard, Paris,1991.
[6] Qui, après la bataille de Bouvines fut le premier roi à être dit « empereur en son royaume ». Duby G., Le Dimanche de Bouvines, Gallimard, Paris,1973.
[7] Qui fit entre 8000 et 20000 morts, pour l’essentiel des gentilshommes et des bourgeois.
[8] Discours de Henri IV au Parlement de Rouen en 1597.
[9] Dont les inspirateurs furent Michel de l’Hospital et Jean Bodin.
[10] Berger H., Henri IV à la bataille de Fontaine-Française, Dijon, 1958. Et l’on se souvient de l’apostrophe d’Henri IV dans le courrier qu’il envoya au Duc de Biron « pends toi, brave Biron… ».
[11] Babelon J-P., Henri IV, Fayard, Paris, 1982.
[12] https://www.valeursactuelles.com/politique/budget-italien-melenchon-prend-le-parti-de-salvini-100250
[13] Taylor E., Primitive Culture, New York, Harper & Row, 1958, p.1.
[14] Levi-Strauss, C., Le Regard Eloigné, Paris, Plon, p.39.
[15] Lévi-Strauss C., « Un autre regard », In L’Homme, 1993, tome 33 n°126-128. La remontée de l’Amazone. pp. 7-11, p. 10.
[16] Cité par Terray, E., « La vision du monde de Claude Levi-Strauss » in L’Homme, 2010, vol. 1, n° 193, pp. 23-44, p. 26.
[17] Sapir J., La Démondialisation, Paris, Le Seuil, 2011.
[18] Levi-Strauss, C., Le Regard éloigné. Paris, Plon, 1983, pp. 47-48.
[19] Lacan J., La direction de la cure et les principes de son pouvoir (1958), Ecrits, Seuil, 1966
[20] Keynes J.M., « National Self-Sufficiency, » in The Yale Review, Vol. 22, no. 4 (Juin 1933), pp. 755-769.
[21] Voir T. Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times: The case of America, Allen & Unwin, Londres, 1924. Voir aussi, T. Veblen, The Theory of the Leisure Class, Macmillan, New York, 1899.
[22] Tversky A., « Rational Theory and Constructive Choice », in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, Basingstoke – New York, Macmillan et St. Martin’s Press, 1996, p. 185-197 ; Kahneman D., « New Challenges to the Rationality Assumption » in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C. Schmidt (edits.), The Rational Foundations of Economic Behaviour, New York, St. Martin’s Press, 1996, p. 203-219. Slovic P. et A. Tversky, « Who Accept’s Savage Axioms? » in Behavioural Science, vol. 19/1974, pp. 368-373. Lichtenstein S. et P. Slovic, « Reversals of Preference Between Bids and Choices in Gambling Decisions », Journal of Experimental Psychology, n°86,/1971, p. 46-55.
[23] Guilluy C. et C. Noyé, Atlas des nouvelles fractures sociales : Les Classes moyennes oubliées et précarisées, Paris, Editions Autrement, coll. Atlas/Monde, 2004.
[24] Sur l’importance fondamentale des « effets de contexte » et « effets de dotation » dans les comportements humains, J. Sapir, Quelle économie pour le XXIè Siècle, Odile Jacob, Paris, 2005, chap. 1.
[25] Rodrik D. et A. Subramanian, « Why Did Financial Globalization Disappoint? » In IMF Staff Papers, Vol. 56, No. 1, Frontiers of Research on Financial Globalization (2009), pp. 112-138.
[26] J. Sapir, La Fin de l’Euro-Libéralisme, Le Seuil, Paris, 2006.
[27] Skidelksy R., John Maynard Keynes, Volume Two. The Economist as Saviour, 1920-1937, Macmillan, Londres, 1992, p. xv.
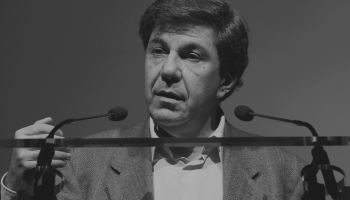


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)